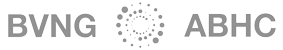Interview avec Francis Balace
Vincent Genin, ULiège
La rédaction de Contemporanea a entrepris il y a près de deux ans une série d’entretiens avec des historiens de l’époque contemporaine qui ont marqué ce champ de recherche depuis plusieurs décennies. Ce projet prend progressivement la forme d’une enquête d’histoire orale, qui a déjà sollicité les regards des professeurs Michel Dumoulin (UCL/ARB), Emiel Lamberts (KUL) et Els Witte (VUB) sur l’évolution de notre métier et de l’étude particulière de cette période en Belgique par le prisme de trajectoires personnelles. Aujourd’hui, nous donnons la parole au professeur Francis Balace (ULiège), dont le parcours à la fois atypique, protéiforme, riche et symptomatique des mutations successives de la place de l’historien dans la société, nous a paru d’un évident intérêt. Né en 1944 à Liège, il poursuit son cursus en histoire dans l’Université de sa ville puis entame une forte thèse de doctorat portant sur La Belgique et la Guerre de Sécession (1861-1865) (soutenue en 1975 et publiée en 1979), et qui, encore aujourd’hui, représente la référence en la matière. Attaquant cette vaste question par les biais que sont l’opinion publique belge, les relations diplomatiques mais aussi économiques - lorsqu’il s’agit de l’important marché que les armuriers liégeois trouveront dans ce conflit lointain - cet historien militaire internationalement reconnu dépasse rapidement les écueils de l’« histoire-bataille ». Il est en effet un analyste fin et un sondeur hors-pair des sentiments nationaux, populaires, patriotiques et des mouvements d’opinion publique, surtout issus de la droite, qui ont traversé la Belgique – parfois venant de l’étranger – des XIXe et XXe siècles. Mais Francis Balace est aussi connu pour ce qui deviendra une forme de carrière « médiatique », entamée en 1975, et dont les compétences seront mobilisées pour élaborer la série Jours de Guerres, en tant que vice-président du Centre de recherches et d’études historiques de la Seconde Guerre mondiale, qui deviendra le CEGES (1984-1997). Il est ensuite connu d’un plus large public pour ses très nombreuses prestations radiophoniques ou télévisées portant sur l’histoire de la monarchie belge mais aussi certains de ses thèmes de prédilection. Rejetant toute pédanterie, tout intellectualisme à bon marché, réticent à l’égard des modes historiographiques, armé d’un humour qui fait office de seconde nature, France Balace présente une ouverture d’esprit toute « anarchiste » qui a trouvé la confiance de centaines d’étudiants depuis plus de 40 ans. Il est surtout un homme fidèle à lui-même, qui, nous ne pensons pas nous tromper, ne met rien plus haut que la liberté individuelle…
Vincent Genin : Vous commencez vos études à l’Université de Liège en 1962. Sentiez-vous alors quel était le statut de l’histoire contemporaine ?
Francis Balace : Ce n’était pas facile de faire de l’histoire contemporaine. Les programmes, en 1962, reposaient sur les Monumenta Germaniae Historica et sur la traduction de chroniques médiévales. En première candidature, quatre-vingt pourcent de notre temps était consacré au latin. Nous avions le cours redouté d’auteurs latins de Louis Delatte - je me souviens de son examen et de l’antichambre improbable dans laquelle nous l’attendions, avec mon condisciple d’alors et qui deviendra mon collègue, Franz Bierlaire. Delatte dictait tout en cours (traductions, commentaires, grammaire) : ce n’était pas le moment d’être distrait. En latin du Moyen-Âge, nous avions Maurice Hélin, père de l’historien Etienne Hélin. Il y avait le séminaire d’histoire de Belgique de Jean Lejeune où nous planchions sur des sources datant de l’épiscopat de Notger. En histoire du moyen-âge, chez Fernand Vercauteren, nous traduisions du Gislebert de Mons. En somme, nous avions 10 à 12h de latin par semaine. Toujours en première, le séminaire d’histoire moderne portait souvent sur un village jusqu’en 1600 (sources en latin). Nous suivions aussi les cours d’Albert Severyns et son Grèce et Proche-Orient avant Homère mais son syllabus à voir par nous-mêmes portait sur la République ! Il y avait aussi des cours dispensés par des non-historiens, tels les romanistes Robert Vivier et Arsène Soreil ou Philippe Devaux, qui faisait bloquer son De Thalès à Bergson ; son cours était donné à tous les candidats en philosophie et lettres mais aussi aux étudiants de la faculté de droit – jusqu’à la fin des années soixante, les juristes devaient suivre une candidature préparatoire en philosophie et lettres. Devaux nous poussait aussi à bloquer des théorèmes de trois pages tandis qu’en psychologie, Jean Paulus avait ajouté à l’intitulé du cours « y compris des notions d’anatomie », choses que j’avais fuies en secondaire. Nous avions certes le cours d’histoire de Belgique de Paul Harsin, qui pouvait ainsi écouler les trois tomes de ses Études critiques sur l’histoire de la Principauté de Liège.
VG : Mais vous vous tournez très rapidement vers l’histoire contemporaine ?
FB : Oui, elle m’intéressait déjà à l’Athénée Charles Rogier (Liège I) où j’avais comme professeur André Zumkir, qui avait été assistant de Robert Demoulin, et publiera des travaux sur la vie électorale à Verviers à l’époque censitaire. Il nous passionnait ; après avoir subtilisé quelques bulletins de votes du siège du parti socialiste, il nous expliquait en classe ce qu’était un « poll ». Á l’Université, lorsque vous prépariez votre mémoire, il était exclu de songer à travailler sur la période postérieure à 1914 – c’était encore trop « frais » et susceptible de polémiques. Comme l’histoire du Premier Empire d’ailleurs. L’histoire contemporaine était alors emmenée à Liège par Robert Demoulin, qui était un peu plus jeune que ses collègues. Ses séminaires portaient sur le rôle de l’opinion publique dans les relations internationales (l’Affaire Schnaebelé de 1887, la crise internationale de 1875 etc.). L’histoire contemporaine m’a séduit tout de suite. Le séminaire se déroulait autour d’une grande table. On était parfois soixante ; je nous vois encore, parfois en surplus, avec nos feuilles sur nos genoux en tentant de prendre note. On était 60 en première et 7 en deuxième. Ces séminaires mêlaient des étudiants d’années différentes, ce qui était dynamique. En histoire moderne, chez Gérard Moreau, sympathique et proche des étudiants, puis chez Léon-E. Halkin, plus distant, il n’y avait pas vraiment de débat contradictoire. Chez Demoulin, les étudiants étaient « sur la sellette » à tour de rôle. Leurs instructions n’appelaient aucune question…Chez Vercauteren, nous devions traduire les sources médiévales. Ces hommes imposaient une certaine distance et un respect : Vercauteren était un élève d’Henri Pirenne, Demoulin avait été prisonnier de guerre, Halkin avait été déporté et résistant : il y avait un background.
VG : Vous avez aussi assisté à la féminisation des études et du monde la recherche.
FB : Oui : c’est à partir de l’Université que nous avons vu des femmes quotidiennement ! Il y avait quelques professeurs femmes, comme Hélène Danthine, Rita Lejeune, Marie Delcourt ou Simone d’Ardenne. Mais nous étions à l’époque où beaucoup de professeurs estimaient que les femmes n’avaient pas vraiment leur place dans la recherche. On en est heureusement revenu.
VG : L’histoire contemporaine a longtemps eu mauvaise presse chez ses collègues traitant des autres périodes de l’histoire.
FB : Oui. Il y avait la confusion avec le journalisme. Et puis, il est vrai que l’histoire contemporaine est née par des historiens comme Frédéric Masson, spécialiste du Premier Empire « au jour le jour », assez anecdotique. L’époque napoléonienne a toujours beaucoup plu au public mais il a toujours été mal vu de l’intégrer à l’Université, or c’est le début de l’histoire dite contemporaine, la seule qui s’allonge d’un jour toutes les 24 heures. Puis, en Belgique, le poids de l’hégémonie gouvernementale catholique (1884-1914) et son souvenir ont longtemps pesé : Godefroid Kurth estimait, dans cet esprit, que l’on ne pouvait étudier la période française. Cela peut se constater dans l’autre sens : certains médiévistes évitaient d’étudier la Querelle des Investitures, qui rappelait trop la Guerre Scolaire.
VG : Et puis, l’histoire contemporaine est – parfois encore aujourd’hui – critiquée pour être la période du « trop » donc du « lourd » ou du « mal pensé » : il y a, semble-t-il, trop d’archives que pour bien ciseler une problématique, et il arrive d’entendre ceci : en histoire contemporaine, une idée suffit pour mener une recherche, les archives existent sans doute. Or, même pour cette époque, il existe des milliers de questions sans archives connues à la clé !
FB : C’est vrai ; mais c’est vrai aussi qu’il peut y avoir surabondance documentaire : Jean Stengers y a consacré un excellent travail. Un fonds peut surgir du jour au lendemain. C’est rarement le cas en histoire médiévale ou moderne.
VG : Cela doit nous inviter à la modestie surtout.
FB : Parfaitement. En matière d’archives, la Belgique est un pays frileux, au regard de la France par exemple. Le meilleur exemple est les archives judiciaires, qui ne sont pas visibles avant un délai de cent ans ou la disparition du patronyme : autant vous dire que, si vous étudiez un collaborateur de la Seconde Guerre qui s’appelle Dupont, on peut toujours attendre…Et puis, il y avait une gérontocratie du pouvoir politique en Belgique. En 1964, durant mes vacances, j’avais souhaité consulté des archives diplomatiques de 1861. J’avais dû adresser une demande qui passait par le Ministre des Affaires étrangères, alors Paul-Henri Spaak. Tout s’est bien passé. Mais imaginez que je me sois intéressé à la politique de neutralité de 1936…C’était inconcevable.
VG : Puis vient votre mémoire autour de l’opinion publique belge face à la guerre de Sécession.
FB : Oui. Mon patron Robert Demoulin avait soutenu en 1932 une thèse très neuve sur la révolution de 1830 et une thèse d’agrégation en 1938 autour de la transformation économique des provinces belges sous le régime hollandais. Attiré par l’histoire économique avant 1940, l’historiographie des Annales ou la sociologie de François Simand, il se tourne après 1945 vers l’histoire des relations internationales. Il avait été marqué par ses cinq années de captivité en Allemagne : ses camarades d’Oflag lui avaient demandé de leur donner des cours sur le rôle des grands hommes dans l’histoire, des relations entre les nations, afin de comprendre ce qui leur arrivait. Il a été séduit par cette approche et en a été convaincu que l’histoire des relations internationales était d’utilité publique. Après 1968, il reviendra à plus d’histoire économique, notamment pour épouser le souhait de ses collègues juristes : cette réorientation n’a pas rencontré l’approbation de tous les étudiants en histoire. Pour ma part, je n’ai jamais eu de passion pour l’histoire économique. C’est sans doute dû à la répulsion suscitée par les cours de Paul Harsin dispensés en fait par Etienne Hélin. Puis, en 1966, je défends mon mémoire autour de la guerre de sécession. J’avais une passion d’adolescence pour ce conflit. Le livre de Pierre Belperron autour de cette période, paru en 1947, parlait de l’intérêt qu’avaient porté certains belges à la question. Cela m’a intéressé. Après mon mémoire, je décroche une Bourse Fulbright et pars une année aux États-Unis, à la George Washington University comme graduate student.
VG : Nous savons que vous maîtrisez parfaitement l’anglais, mais qu’en était-il alors ?
FB : Il n’y avait pas le moindre cours de langues modernes à l’Université, si ce n’est des traductions de textes historiques ou de Shakespeare. J’ai donc appris sur le tas.
VG : Avez-vous été séduit par les États-Unis ?
FB : J’ai été partiellement déçu. Je n’avais qu’une année de bourse. J’étais surtout là pour aller aux National Archives durant les après-midi. Il y avait des livres de références, comme la Diplomatic History of the United States de Samuel Flagg Bemis, parue en 1947. Je m’étais bien sûr renseigné sur les sources américaines avant mon départ. Mon mémoire m’avait amené à fréquenter les archives du Ministère belge des Affaires étrangères, tenu alors Monsieur Desneux ; c’est là que mes idées de thèse ont germé. Par ailleurs, le FNRS avait fait microfilmer un certain nombre d’archives, ce qui était très utile, bien que nous soyons parfois esclaves de la technologie : devant consulter des microfilmes en 24.36, j’ai dû me rendre compte que nous ne possédions plus aucune machine capable de les lire. J’ai beaucoup travaillé à Washington, à la Library of Congress, dans les Pickett Papers.
VG : Puis, vous tombez sur une manne archivistique, en Floride ?
FB : Oui, j’y ai même contracté la malaria ! Mais il y avait en effet, dans les caves de la banque de Sanford, un fonds très riche, celui d’Henry Shelton Sanford. Ces archives m’ont de suite inspiré de la méfiance à l’égard de ce que peuvent écrire les journalistes. Là où, durant mon mémoire, j’avais assidûment dépouillé la presse belge, je me suis rendu compte, grâce aux Sanford Papers, que celle-ci avait été en grande partie arrosée de subsides par les autorités américaines, durant la Civil War.
VG : Avez-vous souhaité de suite faire de la recherche ?
FB : Oui, mais à l’époque – et sans doute toujours aujourd’hui – il y a plus de risque matériellement à se lancer dans la recherche que dans l’enseignement. En 1966, quand je suis sorti, on construisait des Athénées champignons autour de Liège. Nous étions donc, du moins dans la région en matière d’enseignement secondaire, en situation de plein emploi. Et puis on avait le service militaire qui pouvait tomber. Ça compte. Quand j’étais adolescent, mon père avait estimé que faire de l’histoire pouvait à la rigueur mener à un poste fixe dans le secondaire, et au Congo, c’était encore mieux. Et puis, j’ai mené une vie de militaire et d’officier de réserve, que j’ai beaucoup aimée. Ce fut d’ailleurs un déchirement – mathématiques obligent – de ne pas avoir pu aller plus loin. Quand je suis devenu chercheur, ma grand-mère disait, en wallon : « mais que cherche-t-il ?! ». J’ai surtout eu la chance de faire de mon hobby un métier ; c’est une grâce.
VG : C’est une époque, autour de 1968, où l’Université se politise aussi et où vous êtes assistant (1968-1970 puis dès 1972).
FB : Tout se politisait. En histoire, les étudiants étaient briefés sur les opinions des professeurs. Il ne fallait pas être anticlérical chez Halkin, il ne fallait pas être clérical chez Vercauteren, il fallait savoir que Harsin avait la fibre wallonne etc. Mon condisciple, futur professeur et député européen Claude Desama faisait déjà de la politique aux études, ce qui pouvait être mal vu. Mon patron estimait que Rita Lejeune, épouse de Fernand Dehousse et mère de Jean-Maurice Dehousse, tous deux socialistes, était par ce fait trop « marquée » politiquement. C’est l’époque où Jean Gol était à gauche et était l’assistant de François Périn, alors à la tête du Parti Wallon des Travailleurs : quand Périn prenait la parole à l’arrière d’un café devant des ouvriers, Gol le présentait en « Monsieur le Professeur ». Ca détonait. Les tensions étaient nombreuses mais n’étaient pas nouvelles : il y avait eu des petits traumatismes, comme en 1964 lors de l’ « abandon de la craie », à savoir une grève des professeurs suite à la suppression de l’éméritat à traitement plein. Mais, au-delà des clivages, les professeurs étaient très attachés à la notion de génération et n’auraient pas sacrifié cet aspect pour protéger un de leurs poulains. La notion de « camarade » de promotion comptait beaucoup. Après une bourse Fulbright, en 1966, je passe sur un mandat d’assistant d’un an attaché au CIHC de Jan Dhondt. Je reviens à Liège comme assistant avec pour interruption en 1970 mon service militaire. C’était une époque où l’histoire contemporaine semblait une grande terre en friche et où, en tant qu’assistant, vous étiez payé pour chercher. Par le passé, les assistants n’étaient pas payés mais bénéficiaient de défraiements.
VG : Vous intégrez le monde des études américaines et créez un cours d’Histoire des États-Unis mais aussi un cours d’Histoire d’Angleterre, aujourd’hui disparus, au début des années 1980 ?
FB : Au sein des American Studies, l’histoire faisait office de parent pauvre. La part la plus importante allait aux spécialistes de la littérature. Le centre d’études américaines de la Bibliothèque Royale était notamment animé par un futur professeur de littérature américaine de Liège, Pierre Michel. La Royale avait créé la Belgian Luxembourg American Studies Association (BLASA) pour structurer ces études. Les choses prennent de l’importance lorsqu’on crée le Centre d’Enseignement et de Recherches en Etudes américaines (CEREA) à Liège ; on a lors fait venir des historiens français de renom comme Claude Fohlen ou André Kaspi. Mais il y a eu aussi certaines critiques à l’égard des études américaines, en pleine guerre du Vietnam…
VG : Et puis, faire de l’histoire militaire dans les années 1970, à l’époque où l’histoire quantitative règne et où l’École des Annales exerce un fort magistère, n’est-ce pas un risque de marginalisation de l’histoire « en marche » ?
FB : Peut-être. Il est vrai que, dans ce cas, on se coupe de certaines influences, de certains appuis académiques et même d’affinités politiques. On suit sa passion.
VG : Votre rapport au monde des historiens me rappelle aussi une phrase que vous nous disiez, à propos de l’historiographie, pour laquelle vous n’aviez pas un grand goût. Pourtant, ne faut-il pas connaître le dessous des cartes de ce milieu pour en lire les travaux avec critique ?
FB : Oui, il est utile de connaître les réseaux par exemple, mais il faut faire attention à ne pas transformer l’historien en démiurge. Parfois, ce monde tourne au cercle d’admiration mutuelle.
VG : C’est aussi à cette époque que vous devenez vice-président du futur CEGES, en 1984, et que vous vous consacrez à l’étude de la Seconde Guerre mondiale ?
FB. Oui. Ils cherchaient un académique. Á l’époque, Léon-E. Halkin, devenu émérite mais conservant une certaine influence parmi les milieux d’anciens résistants, avait indiqué mon nom et c’est ainsi que j’ai intégré le Centre. Là, je me retrouve avec des chercheurs tels que José Gotovitch. De nombreux fonds d’archives sur des questions encore peu traitées s’offraient au chercheur.
VG : C’est aussi à cette époque que votre « vie médiatique » prend de l’importance et vous bénéficiez d’une visibilité publique.
FB : Cela a commencé en 1975, puis il y eu les émissions Risquons-Tout, d’autres sur Charles Rogier, puis les Jours de Guerre.
VG : C’était aussi l’occasion d’exercer votre talent d’orateur et de vulgarisateur hors du contexte parfois contraignant de l’université.
FB : Je n’ai pas eu de plan par rapport à ce parcours médiatique. Le romaniste Christian Druitte, qui a suivi ses études en même temps que moi, me contactait afin de livrer des analyses historiques.
VG : Comment expliquez-vous le succès de cette carrière dans les médias ?
FB : J’étais calme, peu pontifiant et peut-être que je parlais d’une Belgique « de Papa » qui parlait à certains. C’est aussi intéressant dans la mesure où ce milieu vous amène à rencontrer des gens qui ne font pas votre métier.
VG : Quelles furent vos principales influences intellectuelles dans le métier ?
FB : Dans l’ordre, je citerai en premier Jean Stengers. Mon patron m’avait quelque peu mis en garde contre lui, craignant qu’il ne me vampirise. Il trouvait que son collègue posait parfois un peu trop de questions ! Or, c’était sa nature. Et il pouvait être très généreux. Il lui arrivait de consulter un fonds d’archives et de m’en envoyer des copies précisément utiles pour mes recherches. En second lieu, je citerai un autre ULBiste, Jacques Willequet, qui était dans mon jury de thèse et m’a soutenu. Et enfin, le troisième de Bruxelles, John Bartier. Moins proche des milieux louvanistes, je me suis toutefois lié d’amitié, depuis plus de 45 ans, avec Michel Dumoulin, rencontré à Rome et avec lequel j’ai eu des liens à partir du lancement de sa revue Risorgimento (deuxième génération).
VG : Vous êtes nommé titulaire de la chaire d’histoire contemporaine de l’Université de Liège en 1998. Vos étudiants – dont j’étais – ont été marqués certes par votre humour, la masse de travail que nous demandaient vos cours et séminaires mais aussi, et j’ai remarqué avec le temps que cette tendance n’était pas si répandue dans l’Université, une ouverture d’esprit totale et une conception au fond très globale et peu eurocentrée de l’histoire contemporaine : vous nous parliez d’Afghanistan, de Chine, d’Afrique, de Russie en nous expliquant les codes propres à ces sociétés lointaines et au choc que cela pouvait créer chez les Européens.
FB : Oui, c’était ouvert : nommé pour dix ans et ayant derrière moi une longue expérience, je n’avais pas l’intention de m’ « ennuyer » - et d’ennuyer les étudiants - à donner chaque année le même cours d’histoire contemporaine, autour des mêmes bornes historiques. Et puis, cette ouverture vient aussi du fait que je donnais un cours d’histoire coloniale (devenu expansion et repli). J’avais aussi beaucoup de mémorants.
VG : Un de vos collègues vous a qualifié, ce sur quoi vous semblez tomber d’accord, d’ « anarchiste de droite ».
FB : Oui, c’est assez juste. Avec un côté chouan qui ne me déplaît pas. Mon patron se considérait – cela comptait beaucoup pour lui – comme un fonctionnaire au service de l’État, en tant que professeur d’une Université publique. Pour ma part, je crois plus à la patrie qu’à l’État. Mais ce qui ne m’a pas empêché d’être ouvert à beaucoup de choses : je préférerai toujours un étudiant très marqué à gauche, du moment qu’il travaille, à un autre qui se laisse vivre. Je suis également décidément opposé à toute forme de mode historique et au politically correct, que je ne supporte pas.
Webreferenties
- Michel Dumoulin: http://www.contemporanea.be/fr/article/2016-2-aan-het-woord-genindumoulin
- Emiel Lamberts: http://www.contemporanea.be/fr/article/2017-2-aan-het-woord-emiel-lamberts
- Els Witte: http://www.contemporanea.be/fr/node/276