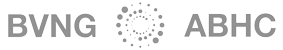Els Witte, parmi les historiens et leur Cité
Vincent Genin
Cette rubrique de Contemporanea ne pouvait faire l’économie de s’adresser à Els Witte. Quel contemporanéiste belge n’a-t-il jamais consulté l’histoire politique de la Belgique qu’elle a co-dirigé en 1988 ? Madame Witte est une personne étonnante, inspirante et dont la bienveillance semble une seconde nature. Née en 1941 à Borgerhout, elle peut être qualifiée de pionnière dans notre métier ; elle fut pour ainsi dire une des premières femmes à accéder au professorat, au décanat et au rectorat parmi les historiens belges. Formée avant 1968 dans l’alma mater¬ gantoise emmenée de main énergique par Jan Dhondt, décidément marquée par l’état d’esprit libérateur de cette époque, Els Witte, dont la carrière se poursuit à la VUB de 1974 à son éméritat, spécialiste reconnue des débuts de la Belgique indépendante, des questions linguistiques, de l’histoire de Bruxelles et de concepts liés à la « nation » ou à la « souveraineté » - et ancienne directrice de la VRT ! - a le rare privilège d’avoir connu le succès éditorial avec son milestone, Het verloren koninkrijk, paru en 2014 et traduit en 2016 en français sur les orangistes belges de 1828 à 1850 (vous trouvez un compte-rendu de ce livre dans ce numéro). Elle n’en perd pas pour autant sa modestie, son goût inextinguible pour la recherche, avec un entrain presqu’estudiantin. Mais aussi un œil sur notre métier, son évolution depuis cinquante et un esprit critique d’une acuité tonifiante. C’est dans un appartement chaleureux, flanqué d’une belle et riche bibliothèque, à deux pas de la Commission européenne, que nous reçoit Els Witte…
Vincent Genin : Etes-vous née dans un milieu propice à la recherche en histoire ?
Els Witte : Je ne suis pas née dans un milieu de chercheurs. Cela étant, mes parents étaient intéressés par les questions d’éducation, dès mon enfance, et il était souvent question de politique chez nous. Une certaine ambiance était là.
VG : Pourquoi avez-vous mené votre cursus à Gand ?
EW : Je suis issue d’un milieu anversois et libre-penseur ; c’est pourquoi j’avais songé à poursuivre mes études à l’ULB. Mais l’histoire contemporaine ne s’y enseignait pas encore en néerlandais. Or, un grand nom en la matière était à l’époque Jan Dhondt, professeur à l’Université de Gand. Nous étions vers 1960, année qui correspond à une époque de démocratisation des études mais aussi de féminisation.
L’histoire contemporaine n’était pas tout à fait prise au sérieux alors…Dhondt, comme Jean Stengers d’ailleurs, était médiéviste de formation. Mais Stengers avait tout de même fait sa thèse sur le sentiment national belge. John Bartier, lui aussi, était spécialisé dans une période antérieure, celle des Bourguignons. Comme Dhondt, il continuait à publier sur son « époque » d’origine. Dhondt souhaitait toutefois jeter les bases d’une histoire contemporaine institutionnalisée, plus identifiable, ainsi que d’une histoire politique et sociale en bonne et due forme. Ce n’est pas pour rien que mon premier article était consacré à la Révolution de 1830 à Alost ! Dhondt a entrepris ce grand projet entouré de toute une équipe, où l’on comptait Balthazar, Van Eenoo, Gaus, Hannes, de Belder, Verhelst, Laureyssen etc. Il y avait là une dynamique et des sujets très nouveaux. Dhondt étant absent plusieurs années pour assurer le rectorat de l’Université de Lubumbashi, c’est le philosophe Kruithof, qui faisait sa thèse sur Hegel, qui m’a orienté vers la science politique et les sciences sociales. Je commence ma thèse dans ce contexte, en 1966, en tant que stagiaire puis aspirante au FRS-FNRS.
VG : Une constante de vos travaux depuis cette époque est l’intérêt marqué pour la Révolution de 1830. D’où vient ce tropisme ?
EW : Dhondt voulait que je vérifie certaines thèses d’Henri Pirenne. Il l’a fait lui-même pour le Moyen-Âge. Les années 1820-1840 posent encore question aujourd’hui aux politiques ou à une opinion plus large. Quant aux historiens, ils sont tous d’accords sur ce que l’on sait de la Révolution ou de l’Orangisme. Cela étant, de nombreuses recherches sur cette époque délaissée de l’historiographie seraient à mener. Dans ma jeunesse, nous étions deux, avec mon collègue de Liège trop tôt disparu André Cordewiener à travailler sur ces questions. Je m’entendais fort bien avec lui. Il faudrait approfondir plusieurs aspects de la remarquable thèse d’agrégation de Robert Demoulin parue en 1938, autour de la transformation économique des Provinces belges de 1815 à 1830. Personne n’a retravaillé sur ces questions ! Pourquoi ne pas étudier plus en profondeur certaines institutions économiques qu’il évoque ?
VG : Vous avez constaté l’intérêt scientifique et social pour cette période suite au succès éditorial de votre Het verloren koninkrijk paru en 2014 aux Bezige Bij et traduit en 2016 en français.
EW : Oui. Je pressentais qu’il y aurait un intérêt en Flandre autour de la question de la résistance à 1830 et des orangistes. Mais il y eut aussi un intérêt du côté francophone. Les deux guerres mondiales du XXème siècle ont littéralement occulté le XIXe siècle. Cela s’est manifesté par les sujets de mémoires de licence puis de master, où un siècle a éclipsé l’autre. La demande sociale pour le XXe siècle est aussi plus grande. Aux Pays-Bas, les recherches sont plus nombreuses sur cette période qu’en Belgique.
VG : La langue des sources de cette période représente-t-elle un obstacle pour certains chercheurs ?
EW : Peut-être en Flandre, où le français est de moins en moins parlé, mais je ne crois pas, fondamentalement. C’est juste l’esprit du temps. Le XXe siècle l’emporte.
VG : L’histoire sociale et politique semble dominer l’orientation de vos travaux. Avez-vous ressenti le poids de l’histoire économique qui, durant les années 1960-1980, semble occuper une forme d’hégémonie ?
EW : L’histoire socio-économique dominait, y compris à Gand. Mais je n’ai jamais souffert de cela. J’avais d’excellentes relations avec Henri Haag, Roger Aubert, Emiel Lamberts, on tenait compte de l’histoire mais aussi de la science politique. Et puis, l’histoire contemporaine n’a pas pris son envol par le canal de l’histoire économique, mais bien celui de l’histoire politique.
VG : L’époque de vos études correspond à l’institutionnalisation de l’histoire contemporaine : le Centre interuniversitaire d’histoire contemporaine est fondé en 1955 par Henri Haag, Robert Demoulin, Guillaume Jacquemyns et Jan Dhondt, la Revue belge d’histoire contemporaine est lancée en 1969 tandis que l’Association Belge d’Histoire Contemporaine voit le jour en 1972. Vous souvenez-vous du CIHC ?
EW : Je m’en souviens bien. On a été introduits dans ses réunions avec d’autres collègues de mon âge. On y jetait les bases de la recherche en histoire contemporaine.
VG : Manque-t-il un « liant » aux contemporanéistes belges aujourd’hui ?
EW : Les organisations « belges » du type du CIHC semblent aujourd’hui impossibles. Les communautés ont acquis leur autonomie sur le plan de la recherche et financier. Voyez les difficultés financières que traversent certaines revues souhaitant conserver un caractère national. Mais il faut conserver le lien entre Nord et Sud.
VG : On a parfois l’impression que les chercheurs du Sud ne lisent pas leurs collègues du Nord, et vice versa. Ce point implique aussi celui de la traduction des travaux. Vous faites partie des rares historiens du pays à prêter un soin particulier à la traduction de vos livres.
EW : J’ai toujours été attachée à la traduction vers le français. Les Néerlandophones lisent souvent l’allemand, l’anglais et le français, tandis que les francophones vont peut-être moins vite vers le néerlandais. Aujourd’hui, 46% des jeunes francophones sortent de l’enseignement secondaire sans avoir suivi des cours de néerlandais. La réalité est là. Aussi longtemps que la Bibliographie de la Revue belge de Philologie et d’Histoire paraîtra, nous n’aurons pas d’excuses d’ignorer la production historique de l’autre partie du pays. Mais, aujourd’hui, dans un contexte où la recherche (FNRS/FWO) est devenue très concurrentielle, les fonds européens et d’autres bourses étrangères sont devenus des recours évidents pour les jeunes ; ils s’inscrivent dans des groupes de recherche internationaux, suivent des grands projets anglophones, et sortent parfois de l’historiographie « belge ».
VG : Vous avez fait partie des fondateurs de l’ABHC/BVNG en 1972 ?
EW : Oui ! L’idée est venue d’un groupe de jeunes chercheurs, dont je faisais partie, avec Emiel Lamberts et d’autres. Le fait que les jeunes historiens se réunissent, cela participait de la mouvance des années 1968-1969, période où les chercheurs se sont davantage fait entendre (j’ai par exemple participé à la Commission Vermeylen, où j’étais active aux côtés de personnes comme Jean-Maurice Dehousse ou le jeune Hervé Hasquin). On voulait défendre nos droits. C’était dans l’air du temps…On se réunissait souvent à la Bibliothèque royale. En théorie, chacun parlait dans sa langue à l’ABHC/BVNG. Nos professeurs se connaissaient entre eux, certes, mais les jeunes étaient coupés les uns des autres, et ne pouvaient exister que par l’intercession du directeur de thèse. C’était assez mandarinal.
VG : Puis, en 1974, vient votre désignation à la nouvelle VUB, autonome de l’ULB depuis 1970. Vous y trouvez une liberté ?
EW : Oui. La mort de Jan Dhondt en 1972 a joué un certain rôle dans cette situation. Herman Balthazar avait été nommé à la VUB mais souhaitait retourner à Gand. Moi, je venais d’une université « ancienne », fondée comme la vôtre en 1817. Elle avait des structures lourdes, masculines sinon « macho », mais avec beaucoup de moyens financiers et d’étudiants – le séminaire d’histoire contemporaine, en fin d’études, ne comptait pas moins de 60 étudiants. À la VUB, il y avait peu d’étudiants mais les profils étaient souvent intéressants. Très tôt, les dossiers que j’introduisais au FNRS/FWO étaient couronnés de succès. Je donnais cours à un grand nombre d’étudiants, puisque je sortais du champ de l’histoire ; le cours d’histoire politique de la Belgique était très suivi. À Gand, les contacts entre les chercheurs des différentes périodes de l’histoire étaient rares. Puis, Etienne Scholliers, Jan Craeybeckx ont intégré la VUB, ainsi que Renée De Bock, qui a joué un rôle très important à cette époque, et qui fut une des premières femmes à évoluer dans ce milieu masculin. Elle a été une des premières femmes Doyen en Belgique. Le féminisme jouait d’ailleurs un certain rôle à la VUB. C’était très « 68 » tout cela ; j’ai d’ailleurs appartenu un temps au mouvement Links, à la gauche de la gauche. Puis j’ai fondé un Centre sur l’histoire de Bruxelles, qui eut un succès immédiat et a vite compté une quinzaine de chercheurs. On collaborait avec les collègues francophones, avec le CRISP aussi.
VG : Votre parcours est pour ainsi dire pionnier - si l’on excepte le cas de Suzanne Tassier dans l’ULB des années 1940-1950 – vous êtes une des premières femmes professeur d’histoire, doyen puis recteur (la deuxième) en Belgique.
EW : Oui, et il y eut un moment important pour moins, qui s’échelonne de 1988 à 1994, c’est ma fonction de présidente de la VRT. Je donnais un cours consacré aux médias, qui m’avait mené à ce poste a priori inattendu. Or, ce fut une expérience fondamentale pour moi, à une période où la télévision privée et commerciale prenait une importance croissante. Il a fallu nous défendre face à cela. J’avais acquis des contacts dans le monde politique mais aussi dans celui de la presse. Une certaine visibilité publique en était la conséquence. Cette situation ne fut pas innocente dans le fait qu’on me poussa à poser ma candidature au rectorat de la VUB. J’ai quelque peu hésité avant d’accepter. Il est dure c’est pour un recteur de continuer à faire des recherches et à enseigner. Le recteur est un arbitre et passe sa vie à entendre des problèmes ! J’ai occupé ce poste et pense avoir rempli ma mission à une époque de rationalisation universitaire, où l’on voulait supprimer certains secteurs. Il a fallu lutter contre cela. En 2000, je quitte la fonction, plutôt heureuse de pouvoir retourner à la recherche et à l’écriture. J’ai reçu de la KUL une Chaire Francqui – c’est à cette époque que j’ai commencé une recherche qui aboutira sur un ouvrage paru en 2003, Over bruggen en muren, où je reviens sur le monde historique en Belgique depuis 1945 et son rapport à la recherche scientifique. Ce fut aussi pour moi l’occasion d’être up to date, après mon immersion rectorale de six ans…
Els Witte: “Quand on n’a pas le temps, on écrit des articles. Quand on a le temps – et désormais je l’ai – on écrit des livres.”
VG : Quel est votre rapport à l’écriture, à la recherche heuristique ?
EW : Je demeure convaincue que pour bien connaître une période, il faut retourner à ses sources, aux archives personnelles. Il existe un certain mépris à l’égard de l’archive. Or, disons-le clairement, ne pas se rendre aux archives au bénéfice exclusif de la théorie et de la littérature historique, c’est une facilité, pour ne pas dire plus. En plus, la conceptualisation et le travail en archives sont deux choses complémentaires ! Les archives permettent de vérifier les concepts. Par exemple, j’étudie en ce moment le concept de « souveraineté du peuple » en 1830. Oui, il faut retourner à Koselleck. Mais aussi aux archives de 1830…
VG : Vous concentrez votre énergie sur l’écriture de livres qui – on le voit – deviennent pour certains des références.
EW : Il y a une différence entre livre et livre. Mon Histoire politique de la Belgique écrite avec Craeybeckx est devenue un manuel réédité à de nombreuses reprises. Je commence à me convaincre que, réédité depuis 1988, il ne devait pas être si mauvais. Ce type de livre est destiné aux étudiants ou à un grand public. Puis, il y a les monographies. J’ai toujours publié des articles-tests à mes futures monographies. Quand on n’a pas le temps, on écrit des articles. Quand on a le temps – et désormais je l’ai – on écrit des livres.
VG : On sait que vous êtes mélomane. Puisez-vous de l’inspiration dans vos goûts musicaux ou littéraires en vue d’écrire l’histoire ?
EW : La musique fait partie de ma vie. Quant au rapport avec la littérature, il implique cette question : l’histoire est-elle une science sociale ou une science « littéraire » ? Moi, je suis très attachée au critère scientifique de l’histoire. Le but est d’être clair et d’employer des concepts exacts ; certes, cela se fait parfois au détriment de la qualité littéraire.
VG : Avez-vous fait école ?
EW : Il faut s’entendre sur ce terme. On a une certaine influence sur les étudiants ; certains suivent trois ou quatre de vos cours en une seule année et vous voient un certain nombre d’heures par semaine. Pour ma part, je n’aime pas le concept “maître”. Il est un peu conservateur, non ? Cela étant, on dirige les jeunes dans un certain sens, malgré nous. Mais ce sont aussi des individus, avec leurs propres idées et qualités. Le professeur occupe donc une place relative dans cette configuration.