Van Schuylenbergh, Patricia et Leduc-Grimaldi, Mathilde (éd.), The Congo Free State: What Could Archives Tell Us? New light and research perspective, Bruxelles, Peter Lang, 2022 (Série Outre-Mers, vol. 9), 412 p.
À la suite du colloque « The Congo Free State Across Languages, Media and Cultures. What Archives and Collections have to say ? » qu’elles ont organisé au Musée royal de l’Afrique centrale en octobre 2017, Patricia Van Schuylenbergh et Mathilde Leduc-Grimaldi ont entrepris la rédaction d’un ouvrage consacré à l’État indépendant du Congo et aux archives qui le concernent. Publié en 2022 sous le titre « The Congo Free State: What Could Archives Tell Us? New light and research perspective », ce volume ambitionne d’explorer « les archives écrites inédites, qu’elles soient manuscrites ou imprimées, et de montrer leur importance cruciale dans le but de revisiter l’histoire de l’État indépendant du Congo » (p. 37). L’ouvrage est structuré en trois parties. La première est composée de contributions concernant les archives et leurs traitements quand les deux parties suivantes rassemblent des études réalisées à partir d’archives relatives au Congo léopoldien. Cette organisation reflète la distance croissante existant entre archivistes et historiens en raison de laquelle les débats sur les archives (coloniales) se déroulent désormais dans deux cénacles distincts.
Une partie significative des archives de l’État indépendant du Congo a été détruite, principalement du fait de l’incendie du palais royal en 1891 et de la volonté du souverain de les voir disparaitre. Fort de ces éléments, il a longtemps été répété qu’il n’était pas possible de documenter le système d’administration et d’exploitation mis en place par Léopold II. Au milieu du siècle dernier, l’archiviste du ministère des Colonies consigne toutefois que « malgré toutes les mesures prises pour se débarrasser des archives de l’État indépendant du Congo, nous sommes surpris de voir ce qu’il en reste ».
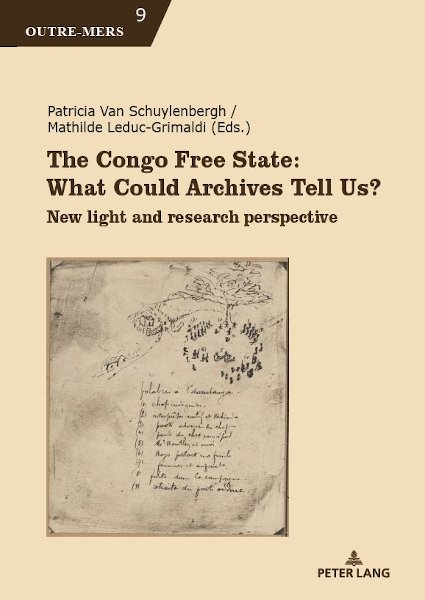
Les premières contributions du volume examinent les dynamiques de production de ces documents ainsi que les interventions archivistiques réalisées en Belgique et au Congo. Les auteurs soulignent la multiplicité des producteurs d’archives, tels que la maison royale, l’administration située en Belgique, le gouvernement local établi à Vivi puis à Boma et les responsables de postes et de missions en ce qui concerne l’administration, les maisons commerciales, les missions religieuses et les institutions d’étude et de propagande, sans oublier les témoins et les acteurs du système léopoldien. Cette cartographie met en évidence que malgré la destruction des archives étatiques, d’autres documents offrent des perspectives intéressantes pour poursuivre l’enquête sur l’État indépendant du Congo. Il n’est toutefois pas toujours aisé d’accéder à ces sources alternatives, car celles-ci sont conservées dans une multiplicité de dépôts notamment aux Archives de l’État (Luis Angel Bernardo y Garcia et Olivier Defrance) et au Musée royal de l’Afrique centrale ou AfricaMuseum (Tom Morren). Aussi, cet ouvrage ambitionne de présenter plusieurs fonds et collections consacrés à la colonisation ainsi que de guider les chercheurs dans cette importante masse documentaire. Cette première partie aurait bénéficié d’un chapitre dédié aux sources conservées au-delà des frontières belges, notamment en République démocratique du Congo.
Les archives discutées dans la première partie de l’ouvrage constituent un des points de départ essentiels pour l’écriture de l’histoire de la colonisation dont il est question dans les parties suivantes. Face à la rareté des archives institutionnelles, les historiens qui contribuent à cet ouvrage se tournent surtout vers les papiers d’agents léopoldiens, tels que Henry Morton Stanley (Mathilde Leduc-Grimaldi), Clément Brasseur (Giacomo Macola), Francis Dhanis (David M. Gordon), Édouard Tilkens (Gert De Wolf) et Adrien van den Hove (Patricia Van Schuylenbergh). Ces documents se composent principalement de correspondance, de notes, de mémoires et de journaux. La plupart sont rédigés en français ou en anglais, mais certains sont produits en arabe. Produits par des commerçants, ainsi que par des agents coloniaux ou des chefs africains, ces ensembles constituent une source privilégiée pour l’étude de l’histoire locale, sociale et religieuse comme le démontre Xavier Luffin. Ils permettent aussi d’accéder à d’autres expériences de la colonisation, contribuant ainsi à diversifier la narration de l’expérience coloniale. Afin de poursuivre dans cette voie, les chercheurs peuvent mobiliser des sources archivistiques consignées dans différents idiomes africains ou des sources orales. Ces démarches heuristiques ne sont toutefois pas représentées dans ce volume. Au-delà des papiers personnels, des sources d’autres natures sont mobilisées par les contributeurs de ce volume. Mathieu Zana Etambala mobilise des archives ecclésiastiques quand Guy Vanthemsche compulse des sources parastatales produites par le Comité spécial du Katanga. Jean-Luc Vellut s’appuie quant à lui sur la presse et sur le The Congo Mirror en particulier. S’il est nécessaire de recourir à d’autres sources que les archives produites par le gouvernement et les structures administratives léopoldiennes, ces dernières demeurent incontournables. À la suite de l’archiviste du ministère des Colonies, nous soulignons que nombre de documents de l’État indépendant du Congo émaillent les fonds d’archives du Congo belge. Loin d’une rupture totale, l’administration coloniale s’inscrit en effet dans la continuité des structures léopoldiennes. Sur le plan archivistique, cela s’observe notamment par le fait qu’elle poursuit les séries léopoldiennes et alimente les dossiers précédemment ouverts. Les nouveaux regards et nouvelles perspectives de recherche doivent mobiliser ce patrimoine.
Les auteurs de ces différents chapitres mettent en évidence que les sources qu’ils mobilisent n’ont pas ou peu été exploitées. En raison de la « culture de négligence » (Vincent Hiribarren) qui a caractérisé la gestion de ce patrimoine archivistique, nombre de fonds et collections ont pendant longtemps été dépourvus d’inventaire ou d’instrument d’accès détaillé ce qui les rendait peu visibles et peu accessibles. Comme le Guide des sources de l’histoire de la colonisation (2021) avant lui, ce volume cherche à remédier à cette situation en contribuant à une meilleure connaissance des archives. Dans l’ensemble, le pari est remporté avec succès.
Rejoignez-nous
Consultez les liens ci-dessous