Rezsöhazy, E., Roden, D., Horvat, S. & Luyten, D., Les 242 dernières exécutions en Belgique : les séquelles de la collaboration (1944-1950) (Bruxelles : Racine-Lanoo, 2023), 292 p.
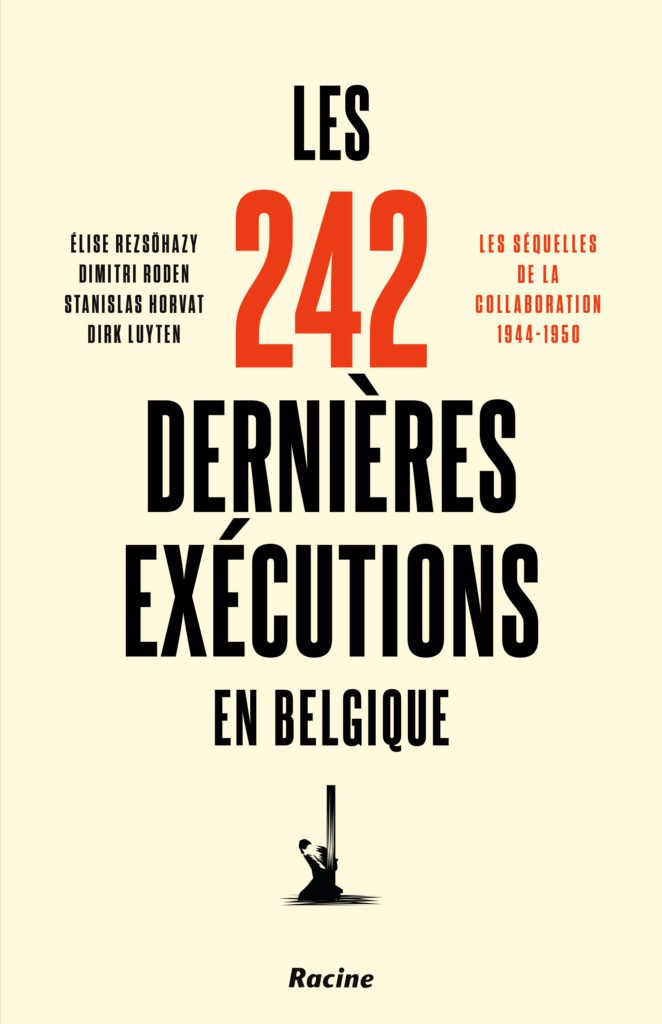
30 mai 1945 : Irma Laplasse-Zwertvaegher, une agricultrice oostduinkerquoise de 48 ans, jugée pour dénonciation par la Cour militaire de Bruges, est fusillée.
30 mai 1995 : suite à des critiques concernant l’instruction, la Cour militaire de Bruges rouvre le dossier. S’appuyant sur le manque de preuves à charge, l’Avocat général demande l’acquittement à titre posthume.
Le 14 avril 1996, la Cour militaire de Bruxelles confirme la culpabilité d’Irma mais commue la peine de mort en réclusion à perpétuité.
Le pourvoi en cassation, lui, est rejeté le 16 décembre 1997, refermant la parenthèse d’un passé toujours présent1.
Avec cet ouvrage, publié aux éditions Racine-Lannoo en 2023, quatre historiens rouvrent sereinement le chapitre de la répression en nous proposant une recontextualisation des 242 dernières exécutions appliquées en Belgique entre le 13 novembre 1944 et le 1er août 1950. Y est présenté le fruit de deux ans de recherches menées dans le cadre du projet Brain 2.0 Postwarex, associant Elise Rezsöhazy (Cegesoma) au prof S. Horvat et Dimitri Roden (École royale militaire) sous la direction de Dirk Luyten. En 2018, les archives de la Justice Militaire sont transférées vers les Archives de l’Etat. L’exploitation du corpus a permis au quatuor de réactualiser l’ouvrage de référence de Luc Huyse et Steven Dhont 2 en insistant sur le rôle tenu par la justice militaire dans la procédure ayant conduit aux 242 exécutions.
Le plan de l’ouvrage s’articule suivant trois phases impliquant l’Auditorat Général, à savoir : le bien-fondé de la condamnation à mort, le recours en grâce pour finir par la mise en œuvre des exécutions. Entre 1944 et 1952, sur les 400 000 dossiers ouverts par l’Auditorat pour faits de collaboration, 1260 aboutissent sur une condamnation à mort au terme d’une procédure contradictoire. Reste que le Ministère de la Justice ne suivra l’avis de l’Auditorat Général que dans 242 dossiers.
Comment expliquer cette ambigüité ?
Pour y répondre, les auteurs ont su exploiter leur matériau. Composé des archives du 4ème bureau de l’Auditorat général, les papiers de la Justice militaire sont mis en relation avec ceux des deux autres instances impliquées : le Ministère de la justice et le Cabinet du Prince Régent. Le tout corroboré par les dossiers judiciaires des 242 exécutés. Cette approche permet de réévaluer le rôle tenu par la Justice militaire dans le processus décisionnel en confrontant sa marge d’action avec celle de l’Exécutif. L’ouvrage cherche aussi à expliciter le sens donné aux exécutions par la justice militaire en assumant les apports et les limites des archives et de l’historiographie politique traditionnelle 3.
Depuis 1863, la Belgique gracie systématiquement les belges condamnés à mort. L’exécution demeure donc une mesure exceptionnelle en Belgique. Rien qu’entre 1831 et 1944, 79 condamnations à mort sont appliquées. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, 12 soldats et 8 espions sont exécutés, avant que le gouvernement ne décide de renouer avec la coutume des grâces 4.
Rien d’étonnant à ce que lors de la préparation des procès pour collaboration, la peine de mort ne soit envisagée, par Henri Rolin, qu’avec réticence comme une option possible dans l’arsenal des peines prévues par les Codes Pénal et militaire de 1867. Entre 1942 et 1944, aucune décision n’est prise par Londres concernant un éventuel recours aux exécutions contre les collaborateurs. Ganshof est alors chargé d’organiser la répression par l’AR du 26 mai 1944. L’approche du rôle de l’Auditorat Général rompt avec l’image de toute puissance associée à l’institution dans l’historiographie. Si l’Auditorat Général est la première instance à émettre un avis sur le bien-fondé de recourir, ou non, à la peine de mort pour sanctionner les collaborateurs, la recherche souligne son caractère non contraignant pour l’Exécutif. En confrontant les rythmes de la Justice Militaire et du monde politique, l’ouvrage montre que jamais les trois auditeurs généraux ne sont maîtres du temps de la répression.
Outre la Justice militaire, les auteurs s’intéressent aux deux autres instances impliquées dans la décision : le Ministère de la Justice et le cabinet du Prince Régent. Le fonctionnement du droit de grâce est mis sur le métier dans le contexte de la répression. A partir de la première grâce – octroyé par Adolphe Van Glabbeke en avril 1946 – il s’agit de voir selon quelles modalités ce droit a été exercé, par qui, et à quel rythme. Poser cette question permet aux auteurs de rabattre les cartes en soupesant les rôles respectifs des représentants des 3 pouvoirs dans une démocratie en reconstruction après la guerre. Autre choix pertinent, le droit de grâce est soumis à une grille d’analyse intégrant à la fois les rythmes de la Justice Militaire, de l’Exécutif et de l’opinion publique 5.
La recherche montre que l’Auditorat Général n’a eu que peu d’impact sur la décision finale : il en a initié le processus et en a assumé l’exécution, une fois l’option posée par les Ministres de la Justice. Au moment de la décision finale, aucune concertation n’est prévue, le Ministre de la Justice préférant se distancer des avis émis par l’Auditorat Général pour se réserver le droit d’assumer la gravité d’une décision en concertation avec le cabinet du Prince Régent. Pour la procédure décisionnelle conduisant aux exécutions, trois conséquences sont à souligner :
- Le décalage grandissant, entre 1944 et 1952, entre les verdicts des tribunaux militaires, l’évolution de la jurisprudence et la mise en œuvre des exécutions.
- La cristallisation des tensions autour du droit de grâce, vu par l’Exécutif comme un moyen de régulation permanent de la répression, au risque de déséquilibrer le jeu des trois pouvoirs.
- Enfin, jamais la peine de mort n’est intégrée dans un continuum de peines mais représente une exception ne pouvant n’être appliquée qu’au cas par cas, suivant le caractère individuel d’une grâce ou d’une condamnation, assumée par l’Exécutif 6.
L’ouvrage met en lumière le respect accordé à la vie humaine par les responsables chargés de sanctionner les collaborateurs. Cette approche a permis de transcender les dossiers emblématiques des collaborateurs politiques pour établir un profil général des 242 exécutés. Il en ressort que l’exécuté moyen est un homme de nationalité belge âgé de 25 à 50 ans. Sur les 242 condamnés, quatre sont des femmes et cinq sont de nationalités étrangères. Les prévenus francophones sont légèrement surreprésentés par rapport aux néerlandophones : 132 ont déclaré le français comme langue de procédure, 110 le néerlandais 7.
En moyenne 56 % des condamnés viennent de Bruxelles, d’Anvers et du Hainaut, des régions stratégiques pour l’occupant. Cela se répercute sur le taux d’exécutions dans chacune de ces provinces, à savoir 105 en Flandre, 14 à Bruxelles et 123 en Wallonie. Si les condamnations à mort pour port d’arme priment en 1944 (79,3%), l’élargissement de la portée des articles 113 et 115 CP amène les magistrats à condamner les prévenus pour aide à l’ennemi. Si 40% des prévenus sont condamnés pour dénonciation – en plus du port d’arme – 75 % d’entre eux le sont en raison de leur engagement au service de l’ennemi ou d’une organisation politique ou paramilitaire affiliée. Neuf exécutés sur dix se retrouvent devant le peloton d’exécution pour s’être rendus coupables de crimes de droit commun commis contre des concitoyens belges. Ceci concerne particulièrement les Zivilfahnder ou Hilfsfeldgendarm chargés de traquer les réfractaires au travail obligatoire 8. Les exécutions sont des mesures exceptionnelles destinées à exclure définitivement, de la communauté nationale, les Belges s’étant rendus coupables de crimes de sang pendant l’occupation.
« Les 242 dernières exécutions en Belgique » fera date dans l’historiographie.
Pour la première fois, le sens donné aux exécutions par la justice militaire est explicité en tant que processus d’exclusion/régulation inhérent au contexte de transition de l’Etat démocratique belge. L’ouverture des archives de la Justice militaire permettrait d’analyser les marges de résilience de la société belge au travers des trajectoires d’exclusion/réinsertion de groupes à peine mis en lumière dans les marges de l’ouvrage ; comme les Zivilfahnder. Les marges de négociation de l’Auditorat Général avec les pouvoirs constitués, la presse et le public pour anticiper les exécutions sont aussi à prendre en considération. Les auteurs engagent, ici, une réflexion sur la manière d’orienter la couverture médiatique des exécutions qu’il importe de poursuivre. En espérant que les fonds photographiques de la justice militaire puissent nous livrer, sinon tous, au moins une partie de leurs secrets…
Références
Rejoignez-nous
Consultez les liens ci-dessous